Le privilège de l’informateur | Revue de droit criminel
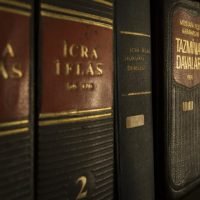
Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2022 QCCQ 1698
[17] Au Canada, la nécessité de protéger les indicateurs de police est reconnue depuis longtemps. [18] La Cour suprême dans l’arrêt Basi résume les critères pour que le privilège de l’informateur s’applique :La question du privilège se pose lorsque, dans le cadre d’une enquête, un policier garantit la protection et la confidentialité d’un indicateur éventuel en échange de renseignements utiles qu’il lui serait difficile ou impossible d’obtenir autrement. On reconnaît depuis longtemps que, lorsque les circonstances le justifient, un marché de ce genre s’avère un outil indispensable pour la détection, la prévention et la répression du crime.[6]
[19] Récemment, dans Personne désignée c. R., la Cour d’appel du Québec rappelle que la Cour suprême a maintes fois exprimé l’importance de l’indicateur pour la police et le système de justice pénale en aidant les enquêtes criminelles, l’arrestation des délinquants, ce qui favorise le maintien de l’ordre public[7]. [20] Elle ajoute au sujet de l’importance du privilège : [86] L’importance du privilège relatif aux indicateurs de police se traduit par la protection absolue de son identité. Il s’agit d’une règle adoptée afin d’atteindre deux objectifs interreliés, soit de protéger la sécurité de la source et d’encourager d’autres personnes à communiquer des informations aux autorités : R. c. Leipert, 1997 CanLII 367 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 281, par. 9 ; R. c. Barros, 2011 CSC 51 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 368, par. 28; R. c. Durham Regional Crime Stoppers Inc., 2017 CSC 45 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 157, par. 11-12.[8] [21] Dans l’arrêt Bisaillon c. Keable, le juge Beetz écrivait :Le principe confère en effet à l’agent de la paix le pouvoir de promettre explicitement ou implicitement le secret à ses indicateurs, avec la garantie sanctionnée par la loi que cette promesse sera tenue même en cour, et de recueillir en contrepartie de cette promesse, des renseignements sans lesquels il lui serait extrêmement difficile d’exercer ses fonctions et de faire respecter le droit criminel.[9]
[22] Le privilège interdit non seulement à l’État de divulguer l’identité de l’informateur, mais également toute information qui pourrait permettre de l’identifier[10]. En ce sens, le privilège est très large. Il n’inclut toutefois pas les renseignements fournis par l’informateur, qui doivent être divulgués à la défense. [23] Le privilège de l’indicateur de police ne souffre que d’une exception, soit celle visant à démontrer l’innocence de l’accusé[11]. Ainsi, « ni le droit à la divulgation de la preuve ni le droit de présenter une défense pleine et entière ne permettent de l’écarter »[12]. [24] Le privilège appartient conjointement à l’État et à l’informateur de sorte que ni l’un ni l’autre ne peut y renoncer unilatéralement[13]. [25] Toutefois, dans certaines circonstances, une personne qui a acquis le statut d’informateur de police et reçu l’assurance de la confidentialité de son identité peut perdre ce privilège. Si dans le cours de sa collaboration avec la police, la personne devient agent double ou agent provocateur, c’est-à-dire un agent civil d’infiltration qui agit sous les directives de la police, son identité pourra être révélée à l’accusé ou au défendeur. [26] Dans l’arrêt Barros, le juge Binnie mentionne :Aucune protection n’est accordée à la « source » dont la conduite va au‑delà de la fourniture de renseignements et qui agit comme « agent provocateur » ou n’est par ailleurs un témoin important du crime. L’agent provocateur et le témoin important ont tous les deux une part active dans toute enquête et procédure criminelle, et leur rôle ne se borne pas au simple fait de donner un « tuyau » à la police. À partir du moment où l’indicateur se rend sur le « terrain » et se met à agir comme un agent de la police, le privilège relatif aux indicateurs de police, qui empêcherait la divulgation de son identité, cesse de s’appliquer à l’égard des événements dans le cadre desquels il agit comme agent : R. c. Broyles,1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 595, p. 607‑609; R. c. Davies (1982), 1982 CanLII 3809 (ON CA), 1 C.C.C. (3d) 299 (C.A. Ont.), p. 303; R. c. Babes (2000), 2000 CanLII 16820 (ON CA), 146 C.C.C. (3d) 465 (C.A. Ont.).[14]
[27] Dans l’arrêt R. v. G.B., la Cour d’appel de l’Ontario fait la distinction entre l’informateur confidentiel et l’agent provocateur :In general terms, the distinction between an informer and an agent is that an informer merely furnishes information to the police and an agent acts on the direction of the police and goes « into the field » to participate in the illegal transaction in some way. The identity of an informer is protected by a strong privilege and, accordingly, is not disclosable, subject to the innocence at stake exception. The identity of an agent is disclosable.[15]
[28] Dans l’arrêt R. v. N.Y., elle ajoute :A confidential informant is a voluntary source of information to police or security authorities and is often paid for that information, but does not act at the direction of the state to go to certain places or to do certain things. A state agent does act at the direction of the police or security authorities and, too, is often paid. The state agent knows that if charges are laid, his or her identity may be disclosed to the defence and that he or she may be required to testify. A major distinction is that a confidential informant is entitled to confidentiality (subject to innocence at stake considerations) and may not be compelled to testify – protections that are vital to the individuals who provide such information, as they often put their lives on the line to provide information that may be vital to state security. A state agent is not afforded such a shield.[16]
[29] Selon la jurisprudence, la différence entre un informateur de police et un agent provocateur tient essentiellement au fait que l’agent agit sous la direction de la police dans sa participation active à l’enquête alors que l’informateur lui fournit des informations de son propre chef. [30] Dans Personne désignée c. R., la Cour d’appel ajoutait ceci au sujet des activités de l’informateur de police et des circonstances dans lesquelles il conserve son privilège : [88] L’utilisation d’indicateurs est un compromis accepté pour assurer l’efficacité des enquêtes criminelles et l’arrestation des délinquants. Un compromis, car l’informateur n’a pas toujours les mains propres. Il n’est pas rare qu’un informateur soit une personne impliquée dans le milieu criminel et connue des policiers, d’où la sensibilité des ententes avec ces personnes. [89] Un informateur peut contrevenir à la loi, à l’éthique ou la morale en divulguant des informations à la police. Cela n’affecte pas le privilège d’indicateur : Solliciteur général du Canada, et al. c. Commission royale (dossiers de santé), 1981 CanLII 33 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 494. [90] Dans ce dernier arrêt, le juge Martland reprenait les propos d’un arrêt anglais pour souligner que la conduite de l’informateur n’est pas déterminante. Le juge Martland poursuit en expliquant que « la règle peut jouer en faveur aussi bien de l’indicateur de police menteur ou malveillant ou vindicatif ou intéressé ou même dément que de celui qui apporte des renseignements par un sens idéaliste de son devoir civil. L’expérience semble démontrer que malgré la possibilité d’abus de l’immunité contre divulgation qui en résulte, il est dans l’intérêt public de respecter, de façon générale, cette immunité » : Solliciteur général du Canada, et al. c. Commission royale (dossiers de santé), 1981 CanLII 33 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 494, 538, citant l’arrêt D. v. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, [1978] A.C. 171, à la p. 233. [91] Dans l’arrêt Hiscock, le juge LeBel, alors à notre Cour, soulignait ce dernier arrêt et, à propos de l’informateur, il notait que :L’informateur joue un rôle souvent important, parfois même essentiel, dans l’action policière et l’application des lois criminelles. Son action se situe à l’occasion dans des marges fort grises. L’on tolère apparemment, dans l’intérêt d’une meilleure application de la justice, la commission de certains actes criminels. L’on permet à l’informateur de réaliser des profits personnels. Son identité est protégée même lorsqu’il pose des actes illégaux ou délictueux, comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’affaire Re Health Records. L’on notera cependant qu’il s’agissait toujours d’actes délictueux commis pour les fins du service de l’État. Dans l’affaire Re Health Records, il s’agissait d’informations recueillies par la police, auprès de médecins ou d’employés d’hôpitaux de l’Ontario, en violation des obligations de ces personnes à leur secret professionnel. L’informateur de police s’était certes mal conduit. Cependant, il n’était pas sorti de son rôle. Les informations étaient recueillies illégalement, mais en vue de l’objectif général de l’application des lois, même si celle-ci impliquait des actes que le droit ou, à tout le moins, la morale, réprouverait.
R. c. Hiscock, 1992 CanLII 2959, [1992] R.J.Q. 895, p. 911-912.
[92] Le juge LeBel exposait ensuite les limites évidentes du privilège en rappelant que :Le privilège de l’informateur ne saurait être interprété et appliqué pour accorder une licence de commettre des actes criminels dans le seul intérêt du prévenu. Il est de nature à couvrir des actes illégaux, voire même criminels, pourvu qu’il demeure orienté vers la fonction de mise en application des lois. Si l’on acceptait l’argument des appelants, le privilège que l’on invoque se trouverait complètement détourné de sa finalité, puisqu’utilisé pour une fin et des intérêts contraires à ceux qui le justifient dans le droit public canadien. […]
R. c. Hiscock, 1992 CanLII 2959 , [1992] R.J.Q. 895, p. 912.
[93] À son tour, en 2017, citant l’arrêt Hiscock, le juge Moldaver, écrivant pour la Cour suprême, rappelait que « l’action de l’indicateur se situe souvent dans des marges grises sur le plan moral et que des individus qui commettent des actes répréhensibles pour fournir des informations à la police peuvent malgré tout avoir droit au privilège relatif aux indicateurs de police » : R. c. Durham Regional Crime Stoppers Inc., 2017 CSC 45 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 157, par. 19. [31] À la suite de ce long passage illustrant les circonstances dans lesquelles le privilège doit être maintenu, le Tribunal procède à l’analyse de la preuve en ayant à l’esprit qu’elle établitque la personne qui a communiqué des informations à l’AMF n’a ni renoncé à son privilège, ni accepté de devenir un agent provocateur, qu’il n’a eu aucun échange avec les défendeurs et qu’il n’a commis aucune action illégale.Source link




